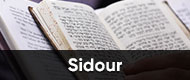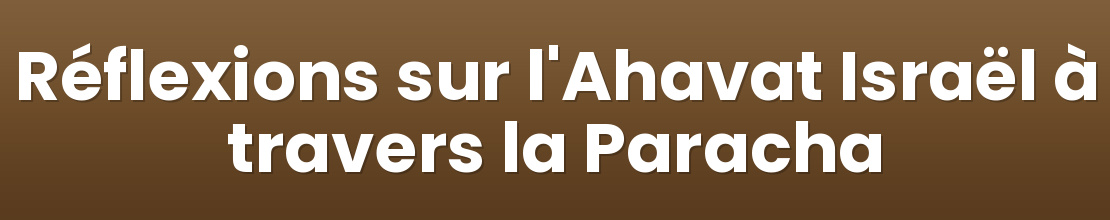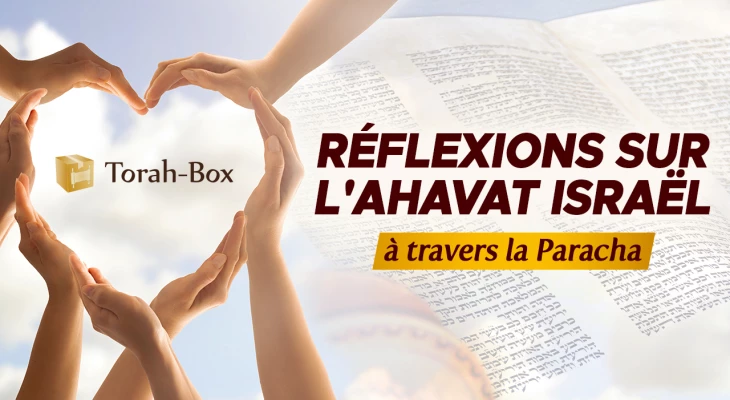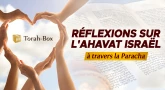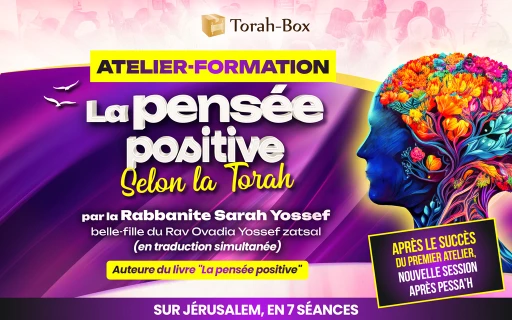La Paracha de Chéla'h Lékha souligne les vertus de certains hommes d’élite, Yéhochou'a bin Noun et Calev ben Yéfouné, qui ont su garder leur indépendance d’esprit, refuser de suivre aveuglement les propos négatifs de leurs collègues, et préserver ainsi leur fidélité à D.ieu. Par ailleurs, notre Sidra nous rappelle la fragilité de l’homme qui peut se laisser prendre au piège de mauvais calculs, et en venir à commettre des fautes terribles.
Effectivement, nos Sages nous indiquent qu’à l’origine, les douze explorateurs étaient des personnalités reconnues, estimées pour leurs vertus, et, même, nous dit-on, des personnes irréprochables.
Néanmoins, le changement de référentiel qu’ils s’apprêtent à vivre : passer d’une vie protégée par l’Éternel dans le désert à une vie autonome en Erets Israël, va faire vaciller dix d’entre eux, à l’exception notable de Yéhochou'a et Calev.
Certains commentateurs avancent l’idée que ces dix chefs de tribus avaient peut-être peur de ne pas être à la hauteur de leur nouvelle mission : bâtir une société qui exige d’eux à la fois un investissement matériel pour subvenir à leurs besoins élémentaires, tout en conservant une vie spirituelle, et une proximité avec le Maître du monde. Ils redoutaient également de perdre le lien privilégié qu’ils entretenaient avec Hachem dans le désert.
Cette perspective les aurait effrayés, et ils ont donc entrepris de dissuader l’ensemble du peuple de conquérir la terre d’Israël.
À l’origine de leur faute, se trouve donc une vision réductrice d’eux-mêmes, du peuple, et de leurs capacités à assumer la tâche que l’Éternel leur a assignée. Cette défiance se traduit dans les mots qu’ils emploient à propos notamment de la rencontre avec les géants : « nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et ainsi étions-nous à leurs yeux. » (Nombres, 13-33). En réalité, explique le Maharal de Prague, la vision qu’un homme porte sur lui-même détermine la perception que les autres auront de lui.
En contrepoint, l’attitude vertueuse de Yéochoua et de Calev incarne une forme de confiance dans les capacités des hommes couplées à la protection divine.
Pour y parvenir, nos Sages nous recommandent de concentrer notre esprit sur l’étincelle divine qui réside en nous, le lien intime qui nous unit au Créateur du monde, et qui est l'antidote pour dépasser les limites liées notre condition matérielle. Cette dernière est déprimante, alors que la première est source d’élévation. L'impératif "Soyez saints, car Je suis saint" peut alors signifier "n'utilisez pas le fait que vous soyez dans une coquille mortelle comme une excuse pour ne pas chercher à atteindre le summum dont vous êtes capables", nous dit le 'Akédat Its'hak.
Comme le remarque le Rav J. Sacks, la Torah décrit à travers l’épisode des explorateurs une réalité éternelle de l’esprit humain que les recherches modernes en sciences cognitives et comportementales ont étayée scientifiquement. Le regard que chaque individu porte sur lui-même et sur ceux qui l’entourent détermine sa relation au monde et aux hommes.
Aussi, le rôle essentiel de tout dirigeant, qu'il assume des responsabilités professionnelles, associatives ou, simplement, en tant que parent, consiste à instaurer un sentiment de confiance parmi les individus qui l’entourent : confiance en eux-mêmes, en leur groupe et en la mission à accomplir. Le dirigeant doit placer sa confiance en ceux qu'il guide et les inspirer à avoir confiance en eux-mêmes. C’est d’ailleurs là l’étymologie latine du mot « confiance » « avoir la foi ensemble ».
C’est en ce sens que l’on peut aussi appréhender, propose le Rav Sacks, le principe psychologique souvent étrange des « prophéties autoréalisatrices ». En effet, on constate que ceux qui pensent "Nous ne pouvons pas le faire" trouvent bien souvent une confirmation à leur scepticisme dans la réalité, alors que ceux qui affirment "Nous pouvons le faire", parviennent parfois à des résultats a priori improbables.
Si l’homme manque de confiance, il crée les conditions de son échec, alors que s’il développe une confiance solide, adossée à une préparation efficace, il pave la voie de son succès. Ainsi lors de la bataille contre les Amalécites (Paracha Bechala'h), la Torah exhorte les Israélites à « regarder vers le haut » afin de gagner, alors qu’inversement, s'ils regardent vers le bas, ils commencent à perdre.
L’espoir en l’avenir, la confiance dans les ressources insoupçonnées de l’homme est précisément ce qui a toujours caractérisé les enfants d’Israël, en dépit de l’adversité qu’ils pouvaient trouver dans les contextes politiques, économiques ou sociaux dans lesquels ils vivaient. Ils rejoignaient ainsi la tradition prophétique qui, même chez les prophètes les plus pessimistes, d'Amos à Jérémie, faisait encore résonner des voix d'espérance.
Ce souci de porter une voix d’espérance est précisément un témoignage merveilleux « d’amour du prochain » et d’un authentique souci de son bien-être. Refusant de céder aux sirènes populistes des discours de peur et de désespoir, Caleb et Yéhochou'a présentent un rapport honnête sur la terre de Canaan. Ils reconnaissent les défis, mais soulignent également les opportunités et la bénédiction divine qui attendent le peuple. Leur courage de dire la vérité, même impopulaire, démontre leur souci du bien-être de la communauté et leur refus de la tromper par des mensonges apaisants.
De même, leur confiance inébranlable en D.ieu leur permet d’encourager et d’inspirer leurs frères et sœurs, même face à l'adversité. Sans chercher à se mettre en avant ou à protéger leurs propres intérêts, ils aspirent à voir le peuple prospérer et accomplir sa destinée en entrant dans la terre promise. Leur dévouement désintéressé pour le bien commun est une manifestation concrète de leur amour pour leurs frères et sœurs.
Enfin, alors que les autres explorateurs se livrent à la médisance et sèment la discorde, Caleb et Yéhochou'a s'abstiennent de tout discours négatif. Ils comprennent que les paroles peuvent blesser et diviser, et choisissent de se concentrer sur les aspects positifs et encourageants de la situation. Leur refus de participer à la médisance est également une grande leçon « d’Ahavat Israël ».
Aussi lorsqu’un homme assume des responsabilité, que ce soit à titre professionnel, communautaire, ou encore familial, il doit être un vecteur de confiance pour ceux qui l’entourent, s’efforcer de les rassurer sur leurs capacités, et leur enseigner, dès le plus jeune âge, que le lien qui les unit au Maître du monde peut leur ouvrir des portes inattendues et constituent une richesse éternelle.
Puisse Hachem nous permettre de progresser dans cette voie !