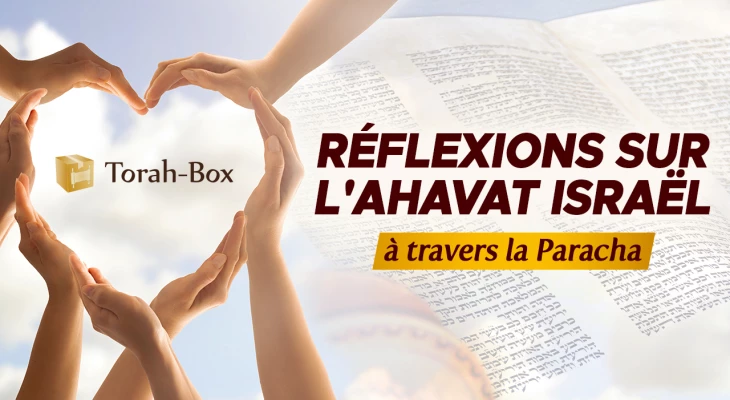La Paracha de Térouma opère une rupture dans le fil des Parachiot du livre de l’Exode. En effet, après une narration épique et exaltante des premiers chapitres évoquant l’esclavage, la sortie miraculeuse d’Égypte, la traversée de la mer, le don de la Torah, la deuxième moitié de ce livre présente de manière très détaillée et technique la construction du Michkan, le Temple portatif qui accompagnera les enfants d’Israël dans le désert.
La sortie d’Égypte s’est accompagnée d’un changement radical de statut pour le peuple : à la terrible âpreté des conditions matérielles de vie durant l’esclavage, a succédé une « douceur de vivre » inédite où tous les besoins fondamentaux étaient pris en charge par la Providence divine : la nourriture céleste leur parvenait régulièrement, leurs vêtements s’adaptaient à leur croissance, ils étaient lavés naturellement, les conditions naturelles étaient favorables etc… Le peuple était ainsi déchargé de tous les efforts nécessaires, en principe, à la vie terrestre. Toutefois, ce « luxe » apparent avait pour corollaire une certaine oisiveté et un sentiment de dépendance, et il pouvait mener à des sentiments paradoxaux : une proximité avec l’Éternel, mais aussi une banalisation et progressivement une ingratitude vis-à-vis des miracles du quotidien.
C’est ainsi que le lecteur de la Torah peut être surpris par les nombreuses plaintes et rebellions du peuple alors que l’Éternel se manifeste pour lui venir en aide avec une intensité et des miracles extraordinaires.
La construction du Michkan présentée dans notre Paracha met fin à cette oisiveté, le peuple doit se mettre au travail. Et dès lors, note le Rav J. Sacks, il cesse de se plaindre. En effet, son esprit et son énergie vont être entièrement mobilisés vers un projet ambitieux, stimulant, et fédérateur. La dépendance laisse place à présent à un sentiment de responsabilité, à mesure que l’oisiveté s’efface devant le labeur collectif.
En outre, nous constatons que lorsque le peuple est occupé à travailler, à produire, à bâtir, il ne pense plus à se révolter ni à se plaindre.
La Torah nous rappelle ainsi que la vocation de l’homme et son épanouissement ne résident pas dans une vie totalement prise en charge par la Providence divine. La bonté de l’Éternel est précisément de laisser une place à l’homme, à son action, à son association avec Lui afin de parachever le monde et la création.
C’est précisément lorsque l’homme agit et travaille qu’il acquiert pleinement sa dignité et quitte la sphère enfantine de la dépendance. S’il est vrai que le travail recèle une dimension aliénante lorsqu’il est accompli de manière excessive, il n’en demeure pas moins que l’oisiveté et la passivité sont tout aussi délétères pour l’esprit humain.
Comme le rappelle le Rav J. Sacks, ce constat a été fait très tôt par le philosophe Alexis de Tocqueville qui avait observé au dix-neuvième siècle, les premières années de la démocratie américaine. Il avait été frappé par la force de « l’esprit d’association » qui prévalait alors au sein de la société américaine et qui valorisait la contribution des particuliers (regroupés sous forme de groupes, de communautés…) à l’effort collectif de l’État. Cet état d’esprit pouvait se résumer ainsi : ne te demande pas ce que l’État peut faire toi, mais demande-toi que tu peux faire pour l’État !
Tocqueville poussait sa réflexion encore plus loin, en mettant en garde contre une menace douce mais terrible pour les démocraties qui consisterait, par confort, à externaliser et déléguer la prise en charge de tous les besoins collectifs à l’État, tout en cherchant à « privatiser » son plaisir personnel. Ce repli sur soi mène progressivement vers un triomphe de l’individualisme qui entrave le réel épanouissement intérieur des hommes.
Aussi, pour éviter cet écueil, il faut mettre le peuple au travail, lui donner des responsabilités et lui permettre de contribuer au monde dans lequel il vit. Il ne s’agit pas, naturellement, d’occuper son temps avec n’importe quel travail, et d’empêcher le peuple de penser en l’abrutissant par un travail harassant. Il s’agit, bien au contraire, de lui permettre de trouver sa dignité en prenant part à un projet collectif qui contribue à l’amélioration du monde. Le travail n’est pas toujours matériel, il peut être intellectuel, spirituel, mais l’idée reste toujours la même : apporter sa contribution à la création ou aux créatures pour les rendre meilleures.
C’est ainsi que le grand maître du moyen-âge, Maïmonide, dans son ouvrage de Halakha, Michné Torah, au chapitre 10 des Lois sur les pauvres, hiérarchise les différents niveaux de grandeur du soutien que l’on apporte aux pauvres. Il tranche alors que le niveau le plus élevé de la Tsédaka consiste à permettre à son frère juif de sortir définitivement de la pauvreté, notamment, en lui permettant de trouver un métier, ou de l’associer gratuitement à un projet commercial. Et, de fait, la grandeur de ce soutien apporté aux pauvres réside précisément dans la volonté de ne pas maintenir son prochain dans un état de dépendance et d’assistanat, mais de lui donner les moyens de son autonomie, en devenant à son tour productif, en contribuant positivement à la société à laquelle il appartient.
À travers la Sidra de cette semaine, la Torah nous éveille ainsi à cette sollicitude, cet « amour du prochain », qui consiste à lui permettre de trouver une place et d’assumer un rôle constructif dans le monde. « La ‘Amal Ha-Adam Youlad » « L’homme a été créé pour le labeur », nous disent nos Sages. Et, précisément, c’est par le travail, le labeur, l’effort que l’homme se construit et qu’il construit le monde, en quittant l’état de dépendance de l’enfance. Le Rav Sacks propose de lire ainsi le jeu de mots des Maîtres du Talmud « Al tikré banayich éla bonayich » « ne lis pas « tes enfants » mais « tes bâtisseurs ».