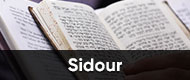La lecture de la Paracha Bo est à la fois familière pour le lecteur de la Torah, mais elle présente aussi une solennité qui ne faiblit jamais. À travers ses versets, nous lisons l’un des épisodes les plus intenses de l’histoire de l’humanité : la sortie d’Égypte, l’affranchissement de l’esclavage à travers des miracles prodigieux.
Cet épisode présente une force spirituelle toute particulière pour le ‘Am Israël, il lui rappelle la sollicitude de l’Éternel à son égard, Sa providence qui le protège et ne l’abandonne jamais au hasard du déterminisme matériel, des causes et des effets de la nature. La sortie d’Égypte est en ce sens un des récits fondateurs de l’espérance qui a accompagné le peuple juif à travers sa longue histoire, et qui lui a permis de traverser les périodes d’oppression en gardant, chevillée au corps, la certitude que l’Éternel viendrait le sauver.
Les versets de la Torah qui décrivent la sortie d’Égypte nous aident à comprendre également la perspective historique dans laquelle le ‘Am Israël a toujours abordé l’histoire, et dans laquelle il a puisé sa force d’espérer.
La sortie d’Égypte est un moment historique fondateur dans la mesure où elle offre la liberté à un peuple qui était asservi depuis plusieurs générations. Or, un tel changement de statut, une telle révolution ontologique à l’échelle individuelle et collective, sont de nature à donner le vertige. Que signifie « être libre » ? Quel usage faire de sa nouvelle liberté ? Comment la protéger ?
Traditionnellement, lorsqu’un peuple accède à la liberté, dans l’histoire moderne, cela donne lieu de grands discours exaltés sur le sens de la liberté, l’importance de la liberté, et la nécessité d’affranchir les peuples de toute servitude. Il suffit de relire les grands discours de Robespierre et Mirabeau lors de la Révolution française, ou la fameuse allocution de Gettysburg d’Abraham Lincoln lors de la guerre d’Indépendance, pour en trouver des illustrations magistrales.
Moché Rabbénou ne fait pas ce choix-là, la nature de son discours est tout autre. Au lieu de se lancer dans un vibrant éloge de la liberté, il semble préoccupé par une seule question : que dira-t-on aux enfants, aux futures générations, de cet évènement ?
Aussi, à trois reprises dans notre texte, Moché évoque explicitement les enjeux de la transmission, et comment les adultes doivent s’efforcer de répondre aux enfants.
« Et quand vos enfants vous demanderont : "Que signifie pour vous ce rite ?, vous direz ... (Exode 12:26-27)
Et vous expliquerez à votre enfant ce jour-là : " C'est à cause de ce que le Seigneur a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte." (Exode 13:8).
Et lorsque ton fils, un jour, te questionnera en disant : "Qu'est-ce que cela ?", tu lui répondras : "D'une main toute puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclavage." (Exode 13:14) »
Cette insistance accordée à la transmission est restée un des enjeux essentiels de la tradition juive à chaque génération. Notre peuple est bien sûr celui de la « mémoire » et de la lutte contre l’oubli. Toutefois, l’enjeu de la mémoire n’est pas de braquer son esprit sur le passé, au détriment du présent, et dans l’insouciance du futur. Il s’agit plutôt de comprendre d’où l’on vient, pour mieux appréhender notre situation présente et préparer notre avenir.
Rav J. Sacks fait ainsi remarquer que certains grands leaders contemporains, à l’instar de Winston Churchill ou David Ben Gourion, étaient aussi des historiens chevronnés. Et c’est précisément, forts de leur connaissance de l’histoire, qu’ils étaient capables de déchiffrer les enjeux du présent, et de prendre les bonnes décisions pour le futur.
La tentation est grande chez les nouvelles générations de faire « table rase du passé, de déposer les valises de l’histoire à l’entrée de sa vie afin d’écrire la sienne à partir d’une feuille vierge. » On ne peut ignorer les arguments qui justifient une telle attitude : combien de traumatismes sont parfois transmis d’une génération à l’autre, parfois même en sautant une ou deux générations ! Combien de parcours de vie sont entravés par des fidélités inconscientes à un passé familial problématique !
Ces arguments sont vrais, ils ne peuvent être ignorés. Toutefois, la volonté légitime de ne pas être l’otage d’une histoire familiale parfois erratique, ne doit pas empêcher l’homme de pouvoir rattacher son histoire personnelle à la grande Histoire qui l’a précédée. Cette dernière n’est pas la somme des faits et gestes de ses ascendants, mais elle rappelle à l’homme le destin des générations dont il est issu, elle lui enseigne les valeurs portées par ses ascendants et elle l’exhorte à prendre sa part, à son tour, dans cette chaîne de la transmission.
Or, précisément, Moché souhaite ici souligner la nécessité de donner aux enfants une identité fondée sur leur histoire. Cette dernière a vocation à être transmise aux enfants à travers une mémoire porteuse d’enseignements moraux et spirituels, qui permettra également de donner aux nouvelles générations une éthique de la responsabilité fondée sur leur passé.
Aussi, au moment précis où le peuple accède à la liberté, Moché Rabbénou, le plus grand prophète de l’histoire, nous rappelle qu’il n’y a pas de liberté durable et authentique sans un regard porté sur l’avenir, et sur les futures générations. Cette liberté que nous avons conquise, que vont en faire nos enfants ? Cette force spirituelle extraordinaire que le peuple a vécue lors de la sortie d’Égypte accompagnera-t-elle encore nos enfants, nos petits-enfants… ? C'est précisément ce souci de la transmission, et du jour d’après qui préoccupe Moché en ces heures historiques pour le peuple.
Et de fait, l’histoire a montré combien la conquête de liberté est parfois vaine lorsque les esprits ne sont pas murs pour la recevoir. C’est ainsi que la Terreur a succédé à la Révolution française, et que la liberté conquise lors des Printemps arabes a été bien souvent de courte durée.
Aussi, l’exercice des responsabilités, d’un leadership à n’importe quelle échelle ne peut se faire sans un regard porté aux plus jeunes et aux nouvelles générations. Il ne s’agit pas seulement de veiller à leur formation intellectuelle, mais également de se préoccuper de leur avenir spirituel.
La liberté individuelle s’acquiert notamment dans une relation apaisée avec son passé. Lors de la sortie d’Égypte, il s’agissait de transmettre aux générations futures la conscience de la Présence bienveillante et protectrice de D.ieu à nos côtés, aussi bien dans les moments fondateurs de notre histoire que dans chaque instant de nos vies. C’est là l’objet des questions que posent les quatre enfants le soir du Séder de Pessa'h et qui constituent une étape fondamentale du récit de la libération d’Egypte.
C’est ainsi que l’on permet aux enfants de faire l’apprentissage de la transcendance, d’acquérir une confiance dans la Providence divine, et d’être portés par une force positive et constructive tout au long de leur vie.
Il ne suffit pas de renverser un tyran, de proclamer son indépendance politique, ou même d’organiser une élection démocratique pour conquérir la liberté authentique. Certes l’État de droit, l’existence de garanties institutionnelles contre le dévoiement du pouvoir politique et l’autoritarisme sont nécessaires, mais ils ne peuvent rien si les individus ne sont pas eux-mêmes épris de liberté et déterminés à la préserver.
C’est dans ce sens que nous pouvons comprendre ces mots fameux d’un des plus grands juristes américains, le juge Learned Hand dans une allocution aux nouveaux immigrés naturalisés américains en 1944 :
"Je me demande souvent si nous ne plaçons pas trop d'espoir dans les constitutions, dans les lois et dans les tribunaux. Ce sont de faux espoirs ; croyez-moi, ce sont de faux espoirs. La liberté réside dans le cœur des hommes et des femmes… » Et de poursuivre : « L’esprit de liberté est l'esprit qui n'est pas trop sûr d'avoir raison ; l'esprit de liberté est celui qui cherche à comprendre les pensées des autres hommes et femmes ; l'esprit de liberté est celui qui pèse leurs intérêts aux côtés des siens, sans parti pris ; l'esprit de liberté se rappelle qu'aucun moineau ne doit tomber à terre sans être remarqué… »
C’est là, l'une des principales leçons de la Paracha Bo et de la libération des enfants d’Israël d’Égypte. La liberté n’est pas un concept abstrait, ce n’est pas une valeur théorique. Le principal défi n’est pas de la conquérir mais de la préserver vivante et vibrante dans le cœur des hommes et dans le cœur des prochaines générations.
C’est précisément ce que l’Éternel a enseigné à Moché Rabbénou et ce que Moché a transmis à son tour au peuple. Chaque génération ne sera libre que si elle transmet son « l’esprit de liberté » à ses enfants. Il ne s’agit pas de jouir uniquement d’une liberté formelle garantie par des droits civils et politiques, il s’agit avant tout d’ancrer dans son cœur et dans son âme le désir « d’être libres », c’est-à-dire de ne pas être asservis à des désirs chimériques imposés par les relations sociales, les modes, la recherche des honneurs, la jalousie ; en bref, il s'agit d'être affranchis des mauvais instincts.
Comme le note Rav J. Sacks, cette liberté ne peut être transmise que par un processus éducatif soutenu. Elle ne peut pas être déléguée uniquement aux enseignants et aux écoles, elle doit avoir lieu également au sein de la famille, par l’exemple des parents et la fidélité aux enseignements que les générations passées nous ont transmis.
C’est ainsi que la force d’espérer d’un homme repose sur sa capacité à se projeter vers l’avenir, et à préparer ce qui arrivera demain, autant que faire se peut à l’échelle d’un homme, en sollicitant l’aide indispensable du Maître du monde. Voilà pourquoi l’éducation est si importante. Elle est la porte d’accès au futur, et la matrice de toutes les espérances.
Puisse l’Éternel nous permettre de maintenir cette chaîne de la transmission qui a cimenté notre foi, notre fidélité, et notre espoir à travers l’histoire, et nous préparer ainsi à la venue prochaine du Machia’h !