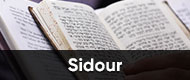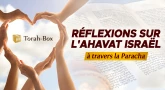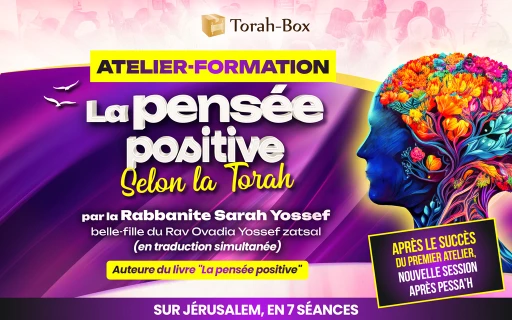Dans son ouvrage Zakhor, Yossef 'Haïm Yérouchalmi met en évidence une particularité essentielle du judaïsme : la mémoire n’y est pas seulement un élément narratif du passé, elle est un impératif religieux et collectif. Contrairement aux récits historiques classiques qui relatent les événements de manière distanciée, la mémoire juive est vivante, incarnée dans chaque génération à travers notamment les fêtes, la liturgie, et l’enseignement spirituel et moral véhiculé par chaque date du calendrier.
C’est précisément cette même idée que l’on retrouve au cœur de la Paracha Zakhor que l’on lira ce Chabbath, et qui ordonne au peuple juif de ne jamais oublier le mal qu’a fait 'Amalek au peuple Juif et d’effacer son souvenir de la terre.
Ici encore, cet ordre n’est pas une simple commémoration d’un passé douloureux. Il est avant tout une injonction à l’action et à la vigilance. Se souvenir d’'Amalek signifie reconnaître que l’injustice et la cruauté existent dans le monde et qu’elles doivent être combattues avec détermination, mais aussi que l’homme peut être porteur en lui d’instincts et de passions destructrices qu’il doit combattre. Aussi, la mémoire, dans la tradition juive, n’est pas une évocation pieuse d’un passé révolu, mais un appel à construire et réparer le monde en tirant les leçons du passé.
Si l’on observe attentivement le récit biblique, on réalisera qu’il a ceci de particulier qu’il ne se contente pas d’enseigner la loi aux enfants d’Israël, mais qu’il leur rappelle également leur propre histoire, les erreurs du passé, mais aussi les promesses de l’avenir.
C’est ainsi, observe Rav J. Sacks, que se structure le discours de Moïse : il fédère le peuple non pas en usant d’autorité, mais par sa capacité à raconter un récit collectif qui donne du sens à la communauté. Par exemple lorsque les enfants d’Israël doivent amener leurs premiers fruits au Temple, ils doivent réciter un court récit retraçant l’histoire de son peuple : « Un Araméen a rendu mon père esclave, il descendit en Égypte... » (Deutéronome 26:5-8), les mêmes versets que nous récitons dans la Haggada de Pessa'h.
À travers ces rituels, nous témoignons que notre histoire n’est pas la simple narration de la vie de nos ancêtres ; elle est une démarche active qui vise à rendre à nouveau palpable l’émotion, et l’intensité de l’évènement originel. D’un point de vue spirituel, nos Maîtres nous enseignent que, pour chaque fête de notre calendrier, le même flux spirituel qui a accompagné l’évènement originel revient dans le monde. À nous de l’accueillir et de prier pour l’orienter favorablement à un niveau individuel ou collectif. Ainsi, à chaque fête de Pessa'h, nous avons la possibilité d’accueillir la force spirituelle de liberté qui a permis de rompre les chaînes de l’esclavage égyptien, pour nous libérer de mauvaises passions, de nos difficultés à titre individuel, et libérer tout le peuple d’Israël de ses difficultés.
Se souvenir n’est pas un acte passif : c’est un engagement actif qui nous inscrit dans l’histoire présente et nous responsabilise.
C’est ici que la distinction entre histoire et mémoire, telle que l’analyse Yérouchalmi, prend tout son sens. L’histoire est un récit des événements passés, souvent figé. La mémoire, en revanche, est dynamique, vivante. L’hébreu biblique ne possède d’ailleurs pas de mot exact pour « histoire », mais utilise Zakhor, qui signifie « se souvenir ». Cette distinction est fondamentale : l’histoire est un enchaînement d’événements passés, alors que la mémoire est une responsabilité transmise, qui façonne l’avenir.
Dans ce cadre, Zakhor ne signifie pas seulement « se rappeler » du mal commis par 'Amalek et de la Mitsva d’effacer son souvenir, mais aussi et surtout, se rappeler que l’on peut et que l’on doit agir pour que le mal ne l’emporte pas. C’est un message d’espoir : l’histoire n’est pas un cycle fataliste, elle peut être transformée. Le judaïsme, en insistant sur la mémoire, affirme que chaque génération a le pouvoir de changer le cours des événements.
La mémoire juive n’est pas réservée à une élite. Comme le souligne Yérouchalmi, elle est démocratisée : chaque Juif est responsable de la transmission du récit, et d’accueillir le flux spirituel qui revient dans le monde de manière cyclique. Ce n’est pas seulement le rôle des érudits ou des dirigeants, mais de toute la communauté. C’est pourquoi, lors du Seder de Pessa’h, chaque personne doit se considérer comme si elle était sortie d’Égypte. L’expérience de la libération ne doit pas être un événement du passé, mais un vécu personnel et collectif.
En demandant à chacun de transmettre à son fils son histoire, Moïse a fait des Juifs une nation de conteurs, de passeurs, plus que cela, de porteurs de mémoire. Cette mémoire a vocation à éclairer la route de la liberté et de la responsabilité individuelles et collectives. En ce sens, se souvenir est la première étape pour agir, pour refuser la fatalité, et pour choisir l’espoir.